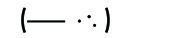•/ Move #1 /•
Fermer la porte. À clef. Par principe. Commodité. La maison n’est pas un coffre à propriétés privés mais une base fonctionnelle à mon image, facilitatrice et connue.
Encore nuit dehors. Nicolas était levé, décalé, il arrive de Tokyo, chercheur en nanotechnologie dans un laboratoire japonais couplé au CNRS du CHR local. Un café. Commun. Moulu à l’épicerie équitable des halles de Wazemmes. Corsé. Saint-Gilles. Colombie je crois.
Encore nuit dehors. Quatre heure du matin. Pas de métro. Borne V’Lille. Insérez votre carte. J’emprunte un vélo. Pardon je loue. Deux cents euros sont ponctionnés, le temps de l’emprunt, prêts à être prélevés si le vélo disparait. Je suis responsable du vélo. Il tient à moi de le replacer dans son socle et le figer de nouveau, me déresponsabiliser de nouveau de ce vélo, ré-enclenché, lumière rouge clignotante, bip émis, puis vert. Libéré du vélo. Soclé. Un prêté pour un rendu.
Un message reçu sur mon téléphone me précise que « à chaque location, une demi heure est offerte. Puis un euro par trente minutes ». J’aime bien lorsque les gens m’offrent une chose que je pense personnellement avoir payé.
Les rues sont vides. Ne me voyais pas traverser la ville à pied avec le lourd sac.
Ai deux sacs. Est-ce assez? Les ai remplis de ce que je juge nécessaire pour presque deux semaines. Un sac, dix ans d’âge, vient de H&M, made-in je sais pas, le faux cuir extérieur s’épluche. L’autre, à dos, est un Fjällräven en toile, produit suédois. Tenue dans le temps.
Vêtements. Le jugé nécessaire. Un drap. Un clavier, connecté si besoin, avec espace de travail familier, historiques et archives, stockage mémoire. Un appareil photo ‘Stylus’. Crayons, trousse. Carnets vierges. Cartes du Massif des Bauges et Routes Vertigineuses du Vercors.
Je possède un vélo mais je ne voulais pas le laisser attaché près de la gare, nuit et jour pendant aussi longtemps. Seul.
Ai un vélo chinois, un « flying pigeon », copie de Raleigh anglais datant de la seconde guerre mondiale, le pédalier changé l’année de sa casse est d’origine française, la roue avant fut importée par Ganesha, un magasin d’encens rue Gambetta, fermé depuis, elle est arrivée par container d’Inde. La sonnette, elle, vient de Berlin, le sandow réparé, recousu, aussi. Le siège bébé est hollandais, adapté sur la selle large du vélo chinois.
Ma présence au monde chevauchant mon vélo n’est pas la même que sur ce V’Lille.
Le V`Lille roule mais il est impersonnel, son image ne me correspond pas mais il est pratique et adapté à l’usage que je veux en faire. Ou plutôt que je ne veux pas faire du mien.
Me sens moins libre qu’avec mon vieux vélo chinois, moi intime, je le connais, le répare, entend très rapidement les bruits annonciateurs d’un problème. Là non. Je monte une masse d’acier. Non familière.
Qui plus est, c’est peut-être un détail pour vous, mais je ne peux occulter les 200 euros de caution, ma carte insérée, les codes reçus sur mon téléphone, qui -insidieusement- me relient à la société. Une société de gestion entreposée entre moi et le vélo. Dormante.
Huilée, mécanique, une société entreposées gérant les dossiers, la maintenance des vélos, les salaires des chauffeurs de la camionnette à remorque réparant, remplaçant les abimés, replaçant les déplacés. Je roule non pas dans la ville, comme habituellement avec mon vélo chinois, mais je chevauche un vélo de la ville. Je ne roule pas dans la ville mais avec la ville.
Et cette infime différence fait je crois beaucoup.
Sur l’un, je suis autonome. Sur l’autre, je dépends.
Cette dépendance est censé être gérée, déléguée, oubliée par l’argent fourni en échange.
Si c’était aussi simple.
L’argent blanchit toujours une complexité.
Gare. Je monte dans un TGV. Tous les autres étaient complets, ai eu une place in extremis. Première classe. Non par choix, mais il ne restait plus que celle-là. J’ai la place handicapé. Achat dernière minute, train complet. La SNCF ( mais la société s’appelle-t-elle encore SNCF ou TGVinOui?), la compagnie gérant les places donc m’a permis d’obtenir une réduction grâce à la carte WEEK-END parce que je pars un samedi. Pour le travail. Mais elle ne le sait pas et s’en fout je crois. Carte vite amortie, ai-je eu l’impression, la première fois suffit: la compagnie m’offrant une réduction sur un billet aux prix fluctuants, gonflé en dernière minute, période de noël.
Une réduction sur du gonflé.
J’aime bien lorsque les gens m’offrent une chose que je pense personnellement avoir payé. Ou que les gens m’offre un service pour m’aider à économiser, à grappiller, sur les prix qu’ils viennent d’augmenter juste sous mon nez.
Le TGV démarre, un message vocal du contrôleur reprend le message SMS reçu sur mon téléphone portable, mais également sur ma boite mail, je vois les engrenages d’un système mécanisé tourner dans ma tête: « suite à une grève, aucune restauration à bord de ce TGV ».
Je ne sais plus à qui appartient le marché de la restauration à bord des TGV, il fut un temps où c’était le groupe ACCOR qui gérait la restauration mais également tout l’entretien du patrimoine immobilier de la SNCF. Une privatisation progressive de l’intérieur, appel d’offre d’un service encore public. Ou qui, à l’époque, paraissait encore public.
L’usager devient client. Vais encore devoir répondre à mail d’une enquête de satisfaction. Le prix élevé de mon billet permet de payer ce service de surveillance de la satisfaction. I can get no…
Le TGV démarre, je pourrais me gausser d’une taxe carbone faible qui ainsi me véhicule vers Lyon et m’arrêter là. Mon esprit file dans les caténaires, friction linéaire du train, synapses alimentant l’électrique moteur, mon esprit s’y engouffre, remonte jusque la centrale nucléaire en bout de course. Je pourrais m’arrêter là.
Mais mon esprit file vers les mines d’Uranium que je placerai en Afrique sans vraiment avoir jamais vérifié.
Dans trois heures je descendrai à Lyon, Part-Dieu. Chiara, anthropologue-géographe, y dépose son fils à la gare. Ensuite nous partons avec son véhicule, équipé de pneus neiges, pour entamer la résidence dans les Parcs Naturels questionnant les nouvelles itinérances.
A regarder les paysages nocturnes défiler par la fenêtre du train, je me demande si, simplement, marcher dans la montagne n’est pas une façon de quitter mentalement tout ce fatras d’imbroglio mentaux. Pour juste être.
Tout seul.
Dans le monde.
Un instant déconnecté de toutes ces liens. Juste être dans un instant dénudé.
La vraie nature serait, non pas uniquement visuelle, « mon corps vu dans la nature » -clic- selfie! Mais mentale, aucun selfie envoyé, un instant déconnecté. Moi ici. Mon sang, coulant, mon temps.
Séparé d’un fatras de liens avec la société, sa corporalité en moi. Moi commun.
Sans trop le vouloir.
Un instant déconnecté. Séparé de la ligne commune, en un imbroglio de fils tressés, pour n’être qu’un point.
Punctum.
Ici et maintenant.
Punctum.
Un coeur qui bat.
Punctum.
Punctum.